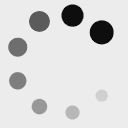La vie quotidienne
06/02/2026 Editos
Les situations extrêmes – génocides, famines, guerres civiles – frappent évidemment l’imaginaire et suscitent l’indignation dans le reste du monde. Mais les réactions s’amenuisent plus les conflits s’enlisent, à mesure que les médias s’en désintéressent, et que la tragédie dépasse l’entendement en termes de victimes et de dommages. L’Ukraine et la Palestine sont les exemples les plus probants de ce phénomène d’usure de la compassion, mais on pourrait citer tous ces conflits qui s’éternisent au Soudan, en République démocratique du Congo, dans le Haut-Karabagh, etc., et qui ne font plus les manchettes depuis longtemps.
Dans ces moments d’engourdissement de notre empathie, il devient salutaire de sortir d’une perspective macroscopique et de faire un « zoom in » sur les individus. Revenir à la vie quotidienne. Comme une façon de prendre la pleine mesure de ce qui se vit; se rappeler que toutes ces situations résumées dans des entrefilets sont vécues. Comprendre une réalité aussi éloignée peut sembler être un exercice d’imagination – mais le cinéma documentaire concourt à nous la rendre imaginable. Intelligible. Compréhensible. Identifiable. Ainsi peuvent rester actives et intactes nos capacités d’indignation, mais surtout notre empathie effective. C’est une chose de savoir que des enfants sont bombardés. C’en est une autre de suivre ces mêmes enfants à l’âge de 11 et 12 ans et de voir ce que les événements ont charcuté de leurs parcours.
La cinéaste palestinienne Mai Masri a été élevée au Liban, à quelques kilomètres du camp de réfugié·e·s palestinien·ne·s de Chatila. Après des études en cinéma à San Francisco (sa mère est américaine), elle revient à Beyrouth dans les années 80 et se met à documenter la vie sous l’occupation israélienne. Figure importante du cinéma palestinien indépendant et réalisatrice pionnière, elle s’évertue à humaniser les victimes du conflit, notamment en offrant des bribes d’espoir et des exemples de possibles reconstructions. Ce faisant, elle empêche la démission du public devant une situation désespérée. Dans Les enfants de Chatila et Rêves d’exil, les deux films que nous vous présentons cette semaine, Mai Masri suit le quotidien d’enfants et d’adolescent·e·s des camps de Chatila à Beyrouth et de Dheisheh en Cisjordanie.
La perspective de Masri sur le réel en est une teintée de poésie et de beauté, malgré un regard frontal sur les horreurs. Son œuvre cherche à faire advenir le peuple palestinien, le rendre visible en dépit des tentatives d’annihilation, elle-même enfant apatride dans un exil permanent. Certaines scènes, savamment construites, nous font basculer du côté du rêve, offrant des échappées poignantes à la réalité carcérale des camps. C’est ce mélange de tendresse désarmante, d’espoir qui suinte à chaque craquellement du tragique, de beauté dans les décombres et d’espoir forcené qui rend ces deux films profondément bouleversants. Vous ne ressortirez pas indemmes de votre rencontre avec Mona, Manar, Farah et Issa.
Quand, en 1969, la première ministre israélienne Golda Meir déclarait qu’il n’existait pas de peuple palestinien, elle mettait en évidence un déni d’identité et d’histoire. En réponse à cette provocation, le cinéaste Mustapha Abu Ali, fondateur de la section cinéma de l’OLP et assistant de Godard sur Ici et ailleurs, considéré comme l’un des fondateurs du cinéma palestinien, signait le révolutionnaire They Do Not Exist.
Le film mêle différents registres de documentations; vie quotidienne au camp de réfugié·e·s Nabatia dans le Sud-Liban, camp d’entraînement de guérilleros palestiniens, lettre écrite aux combattants, chants révolutionnaires, conférence de presse suite à des bombardements israéliens, cartons à l’écran référant à divers génocides… Ce faisant, il invente un cinéma révolutionnaire témoignant de la concrétude d’un peuple dédié à sa survivance, tout en l’ancrant dans la réalité plus large de l’impérialisme et des crimes menés en son nom. Le film n’a connu sa première projection en Palestine qu’en 2003, alors que le réalisateur a réussi à entrer clandestinement dans une salle de cinéma improvisée de sa ville natale, Jérusalem, dont l’entrée lui est interdite par Israël.
Le cinéaste Kamal Aljafari (An Unusual Summer, A Fidai Film, Paradiso, XXXI, 108) réalisait, en 2006, ce premier film, qui formera après coup une trilogie. Le toit, c’est le toit manquant de la maison où la famille du réalisateur s’est établie en 1948; une maison inachevée, un projet de construction laissé en suspens… Exil, suspension, inachèvement, absence. Voilà les thèmes que s’affaire à délier Aljafari dans son œuvre en fragments. Ici rendue perceptible par les mouvements incessants d’une caméra qui cherche parmi les ruines et l’absence, Aljafari témoigne des existences en suspens d’un peuple soumis aux plus abjectes tentatives d’effacement.