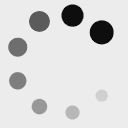Ne clignez pas des yeux
31/10/2025 Editos
Le concept de liberté est forcément dur à circonscrire. Parler de la liberté, tenter de la nommer, de la définir, c’est nécessairement la réduire, l’enfermer dans un espace étriqué, la rabaisser. Il faut l’apport de tous les langages, une stimulation de tous les sens, pour arriver à en transmettre l’énergie, la charge, arriver à faire ressentir un iota de ce que ça génère, provoque, exalte, permet.
L’œuvre du photographe et cinéaste américain d’origine suisse, Robert Frank, s’en approche. Intrépide, iconoclaste, franc et direct, il est l’auteur d’un des livres de photographies les plus connus et les plus marquants du siècle dernier, The Americans (1959). Parcourant son pays d’adoption, il témoigne d’une nation désordonnée, parcourue de lignes de faille, d’injustices sociales, de ségrégation raciale, de pauvreté et de contrastes, mais sans misérabilisme ou didactisme. Robert Frank a un regard brut, de face, et un sens de la beauté et du désespoir proches de celle de la Beat Generation, qu’il filmera d’ailleurs dans le culte Pull My Daisy. C’est un être intransigeant, porté par une énergie volcanique, animé par une nécessité de créer qui dépasse toutes les douleurs individuelles, dont la perte de ses deux enfants.
Nous sommes très heureux·ses de vous présenter pour la première fois avec des sous-titres français le portrait aussi punk que l’est son sujet Don’t Blink - Robert Frank. Réalisé par sa collaboratrice Laura Israel, derrière le montage de plusieurs des films de Frank, le film est une plongée dans l’Amérique beat, rock, brute, furieuse et désespérée; vivante et libre.
Libre. C’est ainsi que l’on aime le cinéma. À des milles de l’idée qu’on peut se faire du documentaire « classique » (linéaire, narratif, démonstratif), nous vous proposons une incursion expérimentale en terre américaine; une exploration des profondeurs du continent, entre l’histoire des Premières Nations et les ravages du colonialisme, terres peuplées de fantômes, de mythes, de métissage, de syncrétisme. Carnets de voyage sans boussole où les indications routières sont des symboles disparus, et où les époques se mélangent dans un vertige ensorcelant.
À l’occasion d’une invitation offerte par nos ami·e·s de VISIONS à Jean-Jacques Martinod, nous avons voulu mettre la lumière sur ce cinéaste, artiste multimédia, conservateur de films, chercheur en sciences abyssales et «anarchiviste» clandestin équatorien. Également programmateur au Mimesis Documentary Festival basé à Boulder, au Colorado, Martinod nous a concocté un programme particulièrement enivrant tiré de la dernière édition.
Au cœur des roches précambriennes du Nord canadien, en Saskatchewan, se trouve l’une des plus grandes réserves d’uranium de la planète, la plus grande énergie destructrice connue de l’homme. Avec Before the Deluge, Martinod signe un carnet de voyage gothique qui invite au dialogue avec les fantômes du territoire : des villes minières abandonnées, englouties dans le chaos du commerce extractif et de la négligence, tandis que les forces liminales et inconnues qui habitent ces terres s’expriment à travers des souvenirs en ombres.
S’il y a une ville du continent américain qui représente cette rencontre improbable de strates historiques, c’est bien la ville de Mexico. Avec son premier long métrage, Aoquic iez in Mexico!, l’artiste visuelle Annalisa D. Quagliata Blanco explore les multiples violences et contradictions au cœur de l’histoire mexicaine au travers de cinq chapitres foisonnants, visuellement éclatés, qui plongent dans les plaies ouvertes de cette nation aux multiples traumatismes et à la richesse symbolique, culturelle et iconographique inouïe. Cette œuvre expérimentale protéiforme est d’une densité intellectuelle et visuelle peu commune, et offre une incursion frénétique et erratique au cœur même des sentiments tortueux de la « mexicanité ». À découvrir sans attendre.
La programmation de Martinod nous permet de découvrir des voix énigmatiques et fascinantes d’Amérique latine. Avec Abajo y a la izquierda (en bas et à gauche), se dévoile le cinéaste chilien Martín Baus, un artiste multimédia, cinéaste, musicien, artiste sonore, chercheur, éducateur et commissaire. Il est membre de CEIS8, un collectif basé à Santiago qui expérimente avec les formats cinématographiques et les procédés photochimiques et codirige le label indépendant Radio Fome, qui produit des œuvres musicales et sonores basées sur l’improvisation. Abajo y a la izquierda réinvente le cinéma politique tout en se jouant des codes à travers un film collage qui invente une géographie de la résistance, « en bas et à gauche » des cartographies hégémoniques. Les voix des radios rebelles d’Amérique latine et les aphorismes révolutionnaires se superposent aux images de Cerro Blanco, un territoire équatorien dont la protection et la destruction sont toutes deux administrées par l’entreprise suisse de matériaux de construction HOLCIM.
Cette nouvelle génération de cinéastes latino-américain·e·s est une des bonnes nouvelles de cette pitoyable année 2025. Merci à Jean-Jacques Martinod d’avoir provoqué cette rencontre qui souffle un petit air de liberté…