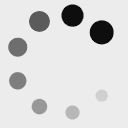Une histoire à soi

Iels s’appellent Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira et Mathieu. Iels ont entre 25 et 52 ans, et sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou encore d’Australie. Ces cinq personnes partagent une identité : celle de personnes adoptées. Séparé·e·s dès l’enfance de leurs familles et pays d’origine, iels ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de vie et leurs images d’archives nous entraînent dans une histoire intime et politique de l’adoption internationale.
| Réalisateur | Amandine Gay |
| Acteur | Naomie Décarie-Daigneault |
| Partager sur |
Il existe peu d’archives qui portent la mémoire de notre naissance. Elles se glissent dans les replis d’un passeport, dans des documents administratifs, dans des clichés où l’on repose, minuscules, dans les bras de nos parents adoptifs.
À travers son documentaire, l'autrice, chercheure, artiste et réalisatrice Amandine Gay trace cette fine ligne entre la réalité de ces questions qui rongent notre présent jusqu’à la moelle du passé. Qui aurions-nous pu être? Quelles traces l’adoption laisse-t-elle?
L’œuvre n’a pas la prétention d’apporter des réponses, mais plutôt de laisser émerger d’autres questionnements que les personnes adoptées peuvent avoir, sans remettre en cause leur légitimité.
Amandine Gay place les archives au cœur de sa démarche – entre celles qui existent et celles qui ne prendront jamais forme. Leur absence témoigne d’elle-même : blessures, deuils... Mais il reste qu’à partir de ce vide, nous rêvons : nous imaginons les traits de nos mères et de nos pères, nous nous inventons des racines et des ancêtres. Nous sommes affamé·e·s de ce qui pourrait nous rendre lisibles, aux yeux de l’Autre, et reconnaissables à nous-mêmes.
En réalisant ce documentaire, Gay souligne l’importance de l’expérience des personnes adoptées et celle de pouvoir se raconter. Si l’œuvre parle à la première personne, c’est pour mieux révéler que l’adoption déborde l’intime : elle est politique. Elle interroge le droit des enfants, bouscule les fondements de la justice reproductive, et appelle à repenser ce que l’on croit immuable.
Marilie Ross

-

Français
1h40
Langue : Français
Sous-titres : Français -

English
1h40
Langue : English
Sous-titres : English
- Année 2022
- Pays France
- Durée 100
- Producteur CG Cinéma
- Langue Français, Anglais
- Sous-titres Anglais, Français
- Résumé court À travers les récits de vie de cinq personnes adoptées se dessine une histoire à la fois intime et profondément politique de l’adoption internationale.
Il existe peu d’archives qui portent la mémoire de notre naissance. Elles se glissent dans les replis d’un passeport, dans des documents administratifs, dans des clichés où l’on repose, minuscules, dans les bras de nos parents adoptifs.
À travers son documentaire, l'autrice, chercheure, artiste et réalisatrice Amandine Gay trace cette fine ligne entre la réalité de ces questions qui rongent notre présent jusqu’à la moelle du passé. Qui aurions-nous pu être? Quelles traces l’adoption laisse-t-elle?
L’œuvre n’a pas la prétention d’apporter des réponses, mais plutôt de laisser émerger d’autres questionnements que les personnes adoptées peuvent avoir, sans remettre en cause leur légitimité.
Amandine Gay place les archives au cœur de sa démarche – entre celles qui existent et celles qui ne prendront jamais forme. Leur absence témoigne d’elle-même : blessures, deuils... Mais il reste qu’à partir de ce vide, nous rêvons : nous imaginons les traits de nos mères et de nos pères, nous nous inventons des racines et des ancêtres. Nous sommes affamé·e·s de ce qui pourrait nous rendre lisibles, aux yeux de l’Autre, et reconnaissables à nous-mêmes.
En réalisant ce documentaire, Gay souligne l’importance de l’expérience des personnes adoptées et celle de pouvoir se raconter. Si l’œuvre parle à la première personne, c’est pour mieux révéler que l’adoption déborde l’intime : elle est politique. Elle interroge le droit des enfants, bouscule les fondements de la justice reproductive, et appelle à repenser ce que l’on croit immuable.
Marilie Ross
-

Français
Durée : 1h40Langue : Français
Sous-titres : Français1h40 -

English
Durée : 1h40Langue : English
Sous-titres : English1h40
- Année 2022
- Pays France
- Durée 100
- Producteur CG Cinéma
- Langue Français, Anglais
- Sous-titres Anglais, Français
- Résumé court À travers les récits de vie de cinq personnes adoptées se dessine une histoire à la fois intime et profondément politique de l’adoption internationale.