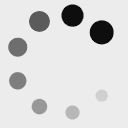Commune révolte

Cinq films du passé pour cultiver la révolte du présent.
« Le surgissement du Tout ou Rien montre que la révolte, contrairement à l’opinion courante, et bien qu’elle naisse dans ce que l’homme a de plus strictement individuel, met en cause la notion même d’individu. Si l’individu, en effet, accepte de mourir, et meurt à l’occasion dans le mouvement de sa révolte, il montre par là qu’il se sacrifie au bénéfice d’un bien dont il estime qu’il déborde sa propre destinée. S’il préfère la chance de la mort à la négation de ce droit qu’il défend, c’est qu’il place ce dernier au-dessus de lui-même. Il agit donc au nom d’une valeur, encore confuse, mais dont il a le sentiment, au moins qu'elle lui est commune avec tous les hommes. »
L’homme révolté, Albert Camus, 1951
COMMUNE RÉVOLTE
Au gré des défilements lumineux de nos petites machines individuelles carburant au lithium, cobalt et autres métaux rares, des images de fin du monde…
Une paire de chaussures… Des agents de l’État masqués arrêtant en pleine rue une femme… Un couple de connaissances lointaines en maillots au bord de la mer… Une vidéo ASMR de déportation de migrants… Une publicité d’épilateur miracle… Des enfants démembrés hurlant dans un paysage de ruines… Une description des petits bonheurs quotidiens d’une amie d’enfance sponsorisée par une entreprise de cosmétiques…
Comment dire…
Ça va bien? Tout le monde? Vous survivez? Vous y arrivez?
Ici,
ça
craque.
Il paraît que ça prend quelque chose comme du Sens pour continuer à avancer. Vous arrivez à le dénicher? Vous le trouvez, entre les canicules et les feux de forêt? Quand on apprend que la Caisse de dépôt et placement du Québec a investi 9,6 milliards dans ce que la rapporteuse spéciale de l’ONU Francesca Albanese qualifie d’économie génocidaire? Vous vous dites qu’il faut continuer à préparer sa retraite, investir ses économies pour préparer l’avenir?
Quand l’absurdité du monde déborde, quand la frontière de l’inadmissible est dépassée, il y a volte-face. Quelque chose se cambre, se casse. Cette revendication, ce refus, curieusement, n’est pas que négatif. Comme Camus l’explicite, l’être qui se révolte dit non, mais refuse sans renoncer. « C’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. [...] Il démontre, avec entêtement, qu’il y a en lui quelque chose "qui vaut la peine de…" »
Cette escale débute en 1871, dans le XIe arrondissement à Paris, aux lendemains du siège de Paris et de la capitulation de la France face aux armées prussiennes. Elle débute également dans l’atelier de l’auteur Armand Gatti, loué par Peter Watkins et sa compagnie de production, pour y rejouer les événements de la Commune de Paris avec plus de 200 acteur·trice·s, pour la plupart non-professionnel·le·s. Œuvre culte, cette création collective revisite la plus importante des communes insurrectionnelles par le biais de procédés de mise en scène révolutionnaires, bousculant toutes les conventions, et allant jusqu’à convier les médias de masse dans une couverture anachronique des événements, joués ici en longs plans-séquences. La Commune (Paris, 1871) donne la parole au peuple – ouvrier.ière.s, femmes, pauvres, orphelin.e.s, enfants – et invite à la participation active du public dans une réflexion sur ses propres asservissements. Impossible de résister à la frénésie insurrectionnelle qui donne à ressentir par les plus atypiques moyens la fièvre démocratique qui a inspiré nombre de mouvements socialistes, anarchistes et féministes.
Les mouvements sociaux révolutionnaires ont presque systématiquement comme conséquence de raviver les mouvements féministes. On pourrait dire presque malgré eux, puisqu’il s’agit souvent de la conséquence du machisme se perpétuant au sein même des mouvements, et offrant aux femmes l’exemple parfait que rien ne les libérera sauf elles-mêmes. Autrement dit, la lutte féministe est toujours périphérique même dans les mouvements progressistes, d’où la nécessité de la mener par et pour les femmes, sans compter sur la bonne foi des groupes affinitaires. Avec Y’a qu’à pas baiser!, de Carole Roussopolos, on reste donc en France, trois après les événements de Mai 68, au sein du mouvement féministe alors mobilisé autour de la question centrale du droit et de l’accès à l’avortement. Le corps des femmes – champ de bataille historique – est posé ici comme sujet politique en quête de son autodétermination.
Restons du côté des femmes – la moitié de l’humanité – cette fois pour y adjoindre la lutte pour les droits civiques. 1969, Charleston. Ville pittoresque, visitée pour ses lieux historiques, dont le Fort Sumter, où le premier coup de feu de la Guerre de Sécession a été tiré. Au printemps de cette année-là, les touristes venus visiter les grandes demeures et les beaux jardins caractéristiques du faste de l’époque esclavagiste se sont butés à un tout autre paysage. Des centaines d’employé·e·s de deux hôpitaux – en majorité des femmes noires – ont décidé de faire la grève suite à un licenciement provoqué par la volonté de se syndiquer. Madeline Anderson, première réalisatrice documentaire afro-américaine, a documenté cette importante et victorieuse lutte dans I Am Somebody, devenu incontournable dans l’histoire du cinéma indépendant américain. 31 minutes pour saisir de l’intérieur le concept d’intersectionnalité.
Un des événements phares qui aura marqué l’imaginaire des protestations collectives est définitivement la guerre du Vietnam. Profondément enracinée dans l’histoire coloniale, la guerre aura duré dix ans, causé des millions de morts vietnamiens, dont près de deux millions de civils, des dizaines de milliers de morts américains et aura provoqué un des plus importants mouvements de révolte mondiale. Deux films sont ici proposés pour réfléchir autant à l’organisation politique et sociale de la protestation avec The War at Home que pour décrypter les motivations réelles de cette guerre impérialiste avec Loin du Vietnam. Le premier document dresse le compte-rendu détaillé du mouvement anti-guerre à Madison, dans le Wisconsin, offrant un réel cours de stratégie de résistance collective. Loin du Vietnam, œuvre collective qui compte au générique les cinéastes européens les plus importants des années 60 (Godard, Ivens, Resnais, Marker, Varda, Klein…) alimentera assurément le regard d’aujourd’hui sur les conflits mondiaux déguisés sous des principes moraux. Ce n’est pas parce que l’impérialisme a revêtu de drôles d’habits aujourd’hui qu’il est moins reconnaissable…
Naomie Décarie-Daigneault
Directrice artistique de Tënk
5 produits

Loin du Vietnam
En 1967, Alain Resnais, William Klein, Joris Ivens, Agnès Varda, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard et Chris Marker ont coréalisé ce film pour affirmer leur solidarité avec la lutte du peuple vietnamien. Chacun·e y propose une approche singulière et personnelle de ce conflit, sur fond de colère et de mobilisation de l’opinion publique internationale.

The War at Home
_The War at Home_ explore le mouvement anti-guerre s'étant développé à Madison, dans le Wisconsin, durant la guerre du Vietnam. Il se concentre sur l’intensification des protestations, notamment à l’Université du Wisconsin, ainsi que sur les affrontements violents entre étudiant·e·s et autorités. Le film combine des entretiens avec des militant·e·s, des vétérans et des leaders communautaires, a...

I Am Somebody
Accès abonnement
En 1969, des travailleuses noires de deux hôpitaux de Charleston, en Caroline du Sud, font la grève pour obtenir la reconnaissance syndicale et une augmentation de salaire, mais se retrouvent vite confrontées à l’État et à la Garde nationale.

Y'a qu'à pas baiser !
Une femme prend la décision de ne pas garder son enfant. Le film alterne entre la séquence d’un avortement mené selon la méthode Karman – alors que cette pratique est encore illégale en France – et des images de la première manifestation de femmes en faveur de l’avortement et de la contraception qui a lieu à Paris le 20 novembre 1971.

La Commune (Paris, 1871)
Nous sommes en mars 1871. Tandis qu’un journaliste de la télévision versaillaise diffuse une information lénifiante et tronquée, une télévision communale voit le jour, émanation du peuple de Paris insurgé. Dans un espace théâtralisé, plus de 200 interprètes incarnent, face à une caméra mobile travaillant en plans-séquences, les personnages de la Commune — en particulier la population du quartie...

Loin du Vietnam
En 1967, Alain Resnais, William Klein, Joris Ivens, Agnès Varda, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard et Chris Marker ont coréalisé ce film pour affirmer leur solidarité avec la lutte du peuple vietnamien. Chacun·e y propose une approche singulière et personnelle de ce conflit, sur fond de colère et de mobilisation de l’opinion publique internationale.

The War at Home
_The War at Home_ explore le mouvement anti-guerre s'étant développé à Madison, dans le Wisconsin, durant la guerre du Vietnam. Il se concentre sur l’intensification des protestations, notamment à l’Université du Wisconsin, ainsi que sur les affrontements violents entre étudiant·e·s et autorités. Le film combine des entretiens avec des militant·e·s, des vétérans et des leaders communautaires, a...

I Am Somebody
Accès abonnement
En 1969, des travailleuses noires de deux hôpitaux de Charleston, en Caroline du Sud, font la grève pour obtenir la reconnaissance syndicale et une augmentation de salaire, mais se retrouvent vite confrontées à l’État et à la Garde nationale.

Y'a qu'à pas baiser !
Une femme prend la décision de ne pas garder son enfant. Le film alterne entre la séquence d’un avortement mené selon la méthode Karman – alors que cette pratique est encore illégale en France – et des images de la première manifestation de femmes en faveur de l’avortement et de la contraception qui a lieu à Paris le 20 novembre 1971.

La Commune (Paris, 1871)
Nous sommes en mars 1871. Tandis qu’un journaliste de la télévision versaillaise diffuse une information lénifiante et tronquée, une télévision communale voit le jour, émanation du peuple de Paris insurgé. Dans un espace théâtralisé, plus de 200 interprètes incarnent, face à une caméra mobile travaillant en plans-séquences, les personnages de la Commune — en particulier la population du quartie...