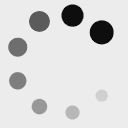I Am Somebody

En 1969, des travailleuses noires de deux hôpitaux de Charleston, en Caroline du Sud, font la grève pour obtenir la reconnaissance syndicale et une augmentation de salaire, mais se retrouvent vite confrontées à l’État et à la Garde nationale.
| Réalisateur | Madeline Anderson |
| Acteur | Naomie Décarie-Daigneault |
| Partager sur |
Qui, en 1970, constitue la catégorie sociale active la plus opprimée aux États-Unis?
Les femmes noires.
Cette prise de conscience au sein du mouvement des droits civiques et du mouvement féministe conduira à l’émergence du concept d’intersectionnalité, essentiel pour saisir les formes combinées de discrimination, au confluent des différences de genre, de classe, de race, d’identité sexuelle, etc. Le black feminism permettra également de mettre en lumière les angles morts du féminisme blanc, dont son « solipsisme » (Adrienne Rich, 1979) qui sous-entendait une identification universelle à la catégorie des femmes blanches privilégiées.
À 43 ans, la cinéaste Madeline Anderson a déjà vécu son lot de discriminations et d’entraves dans sa volonté d’exercer ce métier alors impensable pour les femmes racisées. Après avoir atteint l’exploit de signer le premier documentaire réalisé par une afro-américaine en 1959 avec Integration Report One, elle se bute au sexisme de l’industrie et à ses pratiques exclusives. Lorsque deux hôpitaux tombent en grève à Charleston en 1969 en protestation au congédiement de 12 infirmières noires suite aux tentatives de syndicalisation, Anderson cherche à documenter la lutte. Incapable de financer le tournage pendant les événements, elle sera finalement épaulée par le syndicat pour mener à bien son projet.
I Am Somebody est donc en partie constitué d’extraits d’actualités filmées, d’archives et de séquences mises en scène par Anderson. Formée aux côtés de Richard Leacock, D.A. Pennebaker et Shirley Clarke, figures majeures du cinéma indépendant, Anderson créera un film haletant par le biais d’un montage alternant entre la lutte dans la rue et l’immobilité des discours politiques et des déclarations du pouvoir. Le film recèle en lui une analyse fine de la situation socioéconomique des Afro-Américain·e·s, des conditions particulières d’oppression des femmes noires, et de l’hypocrisie de la société blanche états-unienne dont l’opulence apparente continue de reposer sur une exploitation raciale, héritage direct d’un esclavagisme en théorie aboli.
Si l'œuvre d'Anderson témoigne de la lucidité des opprimé·e·s, sa trajectoire de vie rappelle la nécessité de mener une lutte collective tout autant qu’une émancipation individuelle. Par le biais de la narration portée par une infirmière gréviste, elle incarnera dans I Am Somebody la pulsion indomptable présente en chacun·e pour la liberté – caractéristique première de notre humanité partagée, n’en déplaise aux petits maîtres du monde.
Naomie Décarie-Daigneault
Directrice artistique de Tënk

-

Français
31 mn
Langue : Français
Sous-titres : Français -

English
31 mn
Langue : English
Sous-titres : English
- Année 1970
- Pays États-Unis
- Durée 31
- Producteur American Foundation of Non-violence
- Langue Anglais
- Sous-titres Français, Anglais
- Résumé court En 1969, aux États-Unis, des travailleuses noires de deux hôpitaux font la grève pour obtenir la reconnaissance syndicale et une augmentation de salaire.
- Ordre 1
- Capsule film <p>Découvrez un entretien exceptionnel avec la cinéaste pionnière Madeline Anderson produit en 2015 par <a href="https://www.filmlinc.org/daily/in-conversation-with-madeline-anderson/" target="_blank"><span style="color:#008080;"><u><strong>Film at Lincoln Center</strong></u></span></a>.</p>
- Date édito 2025-07-01
Qui, en 1970, constitue la catégorie sociale active la plus opprimée aux États-Unis?
Les femmes noires.
Cette prise de conscience au sein du mouvement des droits civiques et du mouvement féministe conduira à l’émergence du concept d’intersectionnalité, essentiel pour saisir les formes combinées de discrimination, au confluent des différences de genre, de classe, de race, d’identité sexuelle, etc. Le black feminism permettra également de mettre en lumière les angles morts du féminisme blanc, dont son « solipsisme » (Adrienne Rich, 1979) qui sous-entendait une identification universelle à la catégorie des femmes blanches privilégiées.
À 43 ans, la cinéaste Madeline Anderson a déjà vécu son lot de discriminations et d’entraves dans sa volonté d’exercer ce métier alors impensable pour les femmes racisées. Après avoir atteint l’exploit de signer le premier documentaire réalisé par une afro-américaine en 1959 avec Integration Report One, elle se bute au sexisme de l’industrie et à ses pratiques exclusives. Lorsque deux hôpitaux tombent en grève à Charleston en 1969 en protestation au congédiement de 12 infirmières noires suite aux tentatives de syndicalisation, Anderson cherche à documenter la lutte. Incapable de financer le tournage pendant les événements, elle sera finalement épaulée par le syndicat pour mener à bien son projet.
I Am Somebody est donc en partie constitué d’extraits d’actualités filmées, d’archives et de séquences mises en scène par Anderson. Formée aux côtés de Richard Leacock, D.A. Pennebaker et Shirley Clarke, figures majeures du cinéma indépendant, Anderson créera un film haletant par le biais d’un montage alternant entre la lutte dans la rue et l’immobilité des discours politiques et des déclarations du pouvoir. Le film recèle en lui une analyse fine de la situation socioéconomique des Afro-Américain·e·s, des conditions particulières d’oppression des femmes noires, et de l’hypocrisie de la société blanche états-unienne dont l’opulence apparente continue de reposer sur une exploitation raciale, héritage direct d’un esclavagisme en théorie aboli.
Si l'œuvre d'Anderson témoigne de la lucidité des opprimé·e·s, sa trajectoire de vie rappelle la nécessité de mener une lutte collective tout autant qu’une émancipation individuelle. Par le biais de la narration portée par une infirmière gréviste, elle incarnera dans I Am Somebody la pulsion indomptable présente en chacun·e pour la liberté – caractéristique première de notre humanité partagée, n’en déplaise aux petits maîtres du monde.
Naomie Décarie-Daigneault
Directrice artistique de Tënk
-

Français
Durée : 31 minutesLangue : Français
Sous-titres : Français31 mn -

English
Durée : 31 minutesLangue : English
Sous-titres : English31 mn
- Année 1970
- Pays États-Unis
- Durée 31
- Producteur American Foundation of Non-violence
- Langue Anglais
- Sous-titres Français, Anglais
- Résumé court En 1969, aux États-Unis, des travailleuses noires de deux hôpitaux font la grève pour obtenir la reconnaissance syndicale et une augmentation de salaire.
- Ordre 1
- Capsule film <p>Découvrez un entretien exceptionnel avec la cinéaste pionnière Madeline Anderson produit en 2015 par <a href="https://www.filmlinc.org/daily/in-conversation-with-madeline-anderson/" target="_blank"><span style="color:#008080;"><u><strong>Film at Lincoln Center</strong></u></span></a>.</p>
- Date édito 2025-07-01