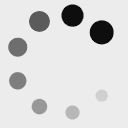Fausto

Sur la côte d'Oaxaca, les rumeurs d'un temps passé ne sont jamais loin de la surface. Des histoires de métamorphose, de télépathie et de relations avec le diable font partie intégrante de la colonisation et de l'asservissement des Amériques. Des personnages de la légende de Faust se mêlent aux habitant·e·s, tout en tentant de coloniser et de contrôler la nature par le biais d'un projet de construction apparemment sans fin. Grâce à la littérature, aux mythes et aux relations locales, le voile entre la réalité et la fiction, le visible et l'invisible, est levé.
| Réalisateurs | Andrea Bussmann, Andrea Bussmann |
| Acteurs | Sofia Bohdanowicz, Sofia Bohdanowicz |
| Partager sur |
J’ai découvert Fausto d’Andrea Bussmann pour la première fois à Locarno, en 2018. Cette année-là, le film a reçu une mention honorable du jury de la compétition « Cinéastes du présent ». Personnellement, je pense qu’il aurait mérité bien plus d’attention et de reconnaissance. C’est un film vers lequel je reviens souvent avec une profonde admiration — une œuvre d’une telle assurance formelle et d’une telle richesse conceptuelle qu’elle en devient doucement révolutionnaire. Situé sur la côte d’Oaxaca et né d’un geste simple — un caméscope offert et l'idée de créer quelque chose pendant les vacances — le film de Bussmann se déploie en une méditation hallucinatoire et stratifiée sur la connaissance, le pouvoir et la narration. Tourné en numérique avec un Sony a7s puis transféré en 16 mm, le film se meut à travers des espaces liminaux, où le mythe se fond dans l’histoire et où la fiction se blottit contre l’anthropologie. S’inspirant du Faust de Goethe, de légendes locales et de Doctor Faustus Lights the Lights de Gertrude Stein (dans une mise en scène du Wooster Group qu’elle avait jadis vue), Bussmann construit une voix off à la fois spectrale et envoûtante — portée par la narration hantée de Gabino Rodríguez, qui plane sur les images comme une incantation. Il en résulte un film qui aborde la pensée anti-impérialiste avec une force discrète, en réfléchissant à l’héritage colonial de la région, à l’électricité et à l’illumination, au désir de savoir et au prix de ce dernier. Le travail minutieux de recherche en amont de Bussmann et ses choix formels intuitifs révèlent un engagement envers une nouvelle forme de cinéma — un cinéma qui refuse le regard extractif et laisse plutôt les récits scintiller et se désintégrer comme du sable. Les ombres s’étendent à l’écran, le temps glisse, et ce qui émerge est une vision radicalement poétique de ce que le cinéma peut faire lorsqu’il écoute. Comme l’écrit Bussmann : « Travailler avec le médium cinématographique, c’est créer de multiples façons de voir par l’exploration formelle. Comment comprenons-nous l’être en relation avec la technologie et la perception? Quelle est la relation entre le virtuel et le réel au cinéma? Comment les images trompent-elles? Y a-t-il un rapport au réel qui produit de la satisfaction? Comment pouvons-nous acquérir de la connaissance par la perception? »
Sofia Bohdanowicz
Cinéaste

-

Français
1h09
Langue : Français
Sous-titres : Français -

English
1h09
Langue : English
Sous-titres : English
- Année 2018
- Pays Mexique, Canada
- Durée 69
- Producteur Andrea Bussmann, Nicolás Pereda
- Langue Espagnol, Anglais, Français, Arabe
- Sous-titres Français, Anglais
- Résumé court Situé à Oaxaca, au Mexique, ce film brouille les frontières entre réalité et fantaisie en explorant les mythologies et le folklore de la communauté.
- Mention festival Mention spéciale · Festival international du film de Locarno 2018
J’ai découvert Fausto d’Andrea Bussmann pour la première fois à Locarno, en 2018. Cette année-là, le film a reçu une mention honorable du jury de la compétition « Cinéastes du présent ». Personnellement, je pense qu’il aurait mérité bien plus d’attention et de reconnaissance. C’est un film vers lequel je reviens souvent avec une profonde admiration — une œuvre d’une telle assurance formelle et d’une telle richesse conceptuelle qu’elle en devient doucement révolutionnaire. Situé sur la côte d’Oaxaca et né d’un geste simple — un caméscope offert et l'idée de créer quelque chose pendant les vacances — le film de Bussmann se déploie en une méditation hallucinatoire et stratifiée sur la connaissance, le pouvoir et la narration. Tourné en numérique avec un Sony a7s puis transféré en 16 mm, le film se meut à travers des espaces liminaux, où le mythe se fond dans l’histoire et où la fiction se blottit contre l’anthropologie. S’inspirant du Faust de Goethe, de légendes locales et de Doctor Faustus Lights the Lights de Gertrude Stein (dans une mise en scène du Wooster Group qu’elle avait jadis vue), Bussmann construit une voix off à la fois spectrale et envoûtante — portée par la narration hantée de Gabino Rodríguez, qui plane sur les images comme une incantation. Il en résulte un film qui aborde la pensée anti-impérialiste avec une force discrète, en réfléchissant à l’héritage colonial de la région, à l’électricité et à l’illumination, au désir de savoir et au prix de ce dernier. Le travail minutieux de recherche en amont de Bussmann et ses choix formels intuitifs révèlent un engagement envers une nouvelle forme de cinéma — un cinéma qui refuse le regard extractif et laisse plutôt les récits scintiller et se désintégrer comme du sable. Les ombres s’étendent à l’écran, le temps glisse, et ce qui émerge est une vision radicalement poétique de ce que le cinéma peut faire lorsqu’il écoute. Comme l’écrit Bussmann : « Travailler avec le médium cinématographique, c’est créer de multiples façons de voir par l’exploration formelle. Comment comprenons-nous l’être en relation avec la technologie et la perception? Quelle est la relation entre le virtuel et le réel au cinéma? Comment les images trompent-elles? Y a-t-il un rapport au réel qui produit de la satisfaction? Comment pouvons-nous acquérir de la connaissance par la perception? »
Sofia Bohdanowicz
Cinéaste
-

Français
Durée : 1h09Langue : Français
Sous-titres : Français1h09 -

English
Durée : 1h09Langue : English
Sous-titres : English1h09
- Année 2018
- Pays Mexique, Canada
- Durée 69
- Producteur Andrea Bussmann, Nicolás Pereda
- Langue Espagnol, Anglais, Français, Arabe
- Sous-titres Français, Anglais
- Résumé court Situé à Oaxaca, au Mexique, ce film brouille les frontières entre réalité et fantaisie en explorant les mythologies et le folklore de la communauté.
- Mention festival Mention spéciale · Festival international du film de Locarno 2018