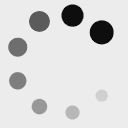La voix de son maître

Douze patrons de grandes entreprises parlent face à la caméra. Du pouvoir, de la hiérarchie, des syndicats, des grèves, de l'autogestion... Leurs voix se mêlent, se dispersent, se démultiplient dans la ville et dans les usines. Sous le discours patronal apparait progressivement l'image d'un monde futur dont les bases sont déjà visibles aujourd'hui. Par une écoute et un regard attentifs, Philibert et Mordillat réussissent une critique subtile de cette réalité propre des patrons dont le pouvoir se fait, au fur et à mesure du film, toujours plus équivoque.
| Réalisateurs | Nicolas Philibert, Gérard Mordillat |
| Partager sur |
Je connaissais un des coréalisateurs du film, Gérard Mordillat, pour sa télésérie remarquée sur Arte dans les années 1990, *Corpus Christi*. Il s’agissait d’une lecture factuelle de la vie de Jésus, le personnage mythique redevenant, grâce aux interprétations d’historiens et de théologiens, une figure historique. Être capable de cerner un sujet d’aussi loin, avec un sens chirurgical de la spéculation, rend l’intéressé apte à cerner une autre figure messianique, vulgaire celle-là : le chef d’entreprise. Le film est pour nous d’autant plus saisissant qu’il date des années 1970. On voit alors les patrons s’effaroucher et innover pour tenter de faire exister, aux belles heures du marxisme, du syndicalisme politique et du socialisme parlementaire, ce qu’on ne reconnaît plus aujourd’hui que comme les tics du pouvoir. Il s’ouvre sur une scène proprement invraisemblable, dans laquelle des chefs d’entreprise réunis redoublent d’inventivité pour trouver la tournure sémantique qui les agrée le mieux afin de se dire eux-mêmes. Or, procédant par élimination et disqualifiant tour à tour les expressions « maîtres », « patrons », « managers », « chefs d’entreprise » et quelles autres encore (« nouvel animal politique », « gagneurs » ou « conquérants du possible » !), ils se trouvent à se trahir et à se portraiturer. C’est un cas spectaculaire de dénégation freudienne : traitant de tout ce qu’ils estiment ne pas être, ils étalent d’eux-mêmes ce qu’il en est de leur fait en tant que cela est inavouable, qui plus est dans un ridicule qu’ils semblent les seuls à ne pas apprécier.
Puis, un à un, les patrons s’épanchent. Y passent l’annonce du pouvoir privé s’érigeant sous la forme des multinationales, le pouvoir anonyme d’un capital mondialisé rendant légitime la figure autoritaire et non démocratique du PDG, les nouvelles pratiques de management rendant le subordonné partenaire de la structure qui l’opprime, la neutralisation ou le dépassement de l’État social. Le pouvoir industriel et financier nous annonce lui-même, dans un français daté et dans un noir et blanc d’un autre temps, l’organisation du monde telle que nous la connaissons maintenant, celle-là même dont nous crevons.
Comme le proposent les réalisateurs dans des effets de montage, ces propos deviennent hégémoniques déjà à l’époque, et passent dans les foyers à la manière d’un évident discours de référence. C’est au plus près du développement de l’idéologie qu’on tourne ici. Plus besoin de Marx, les dirigeants parlent eux-mêmes dans les termes de l’ancienne critique, se dépersonnalisent dans de prétendues lois de l’histoire et règles du management, au sens où, s’ils se croient compétents, ils se savent surtout interchangeables. Le contraste brutal entre les prises de position des patrons et les scènes témoignant d’un accablant travail à la chaîne de la part de leurs personnels semble moins relever d’un fait de mensonge de leur part que d’une situation d’ignorance.
Comme le signalera un sociologue comme Luc Boltanski¹ à la même époque, le patron est celui qui fixe des objectifs et des directives sans nécessairement savoir par le menu comment s’organise le travail dont les rendements dépendent. David Greaber le corroborera plus tard². Paradoxalement, on finit par regretter cette époque où les dirigeants du secteur privé se montraient aussi ouvertement conscients de leur positionnement historique et social – les marxistes les y contraignaient – et aussi prolixes. (Aujourd’hui, seuls les pdg successifs de Total, en France, le restent autant.) Dans ce documentaire exceptionnel, ce n’est pas seulement leur discours qui pèse, mais le dispositif où ils choisissent d’être filmés, de même que les attributs du pouvoir qu’ils arborent et leur saillant langage du corps. C’est qu’une horde de *communicants* n’existe pas encore à l’époque pour les conseiller.
¹ Luc Boltanski, *Les cadres. La formation d’un groupe social*, Paris, les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1982.
² David Graeber, *Bureaucratie. L’utopie des règles*, Paris, Actes Sud, coll. « Babelio », 2015.
Alain Deneault
Philosophe
- Année 1978
- Pays France
- Durée 96
- Producteur INA, Laura Productions
- Langue Français
- Résumé court Douze patrons de grandes entreprises parlent face à la caméra. Du pouvoir, de la hiérarchie, des syndicats, des grèves, de l'autogestion...
- Programmateur Alain Deneault|Philosophe;
Je connaissais un des coréalisateurs du film, Gérard Mordillat, pour sa télésérie remarquée sur Arte dans les années 1990, *Corpus Christi*. Il s’agissait d’une lecture factuelle de la vie de Jésus, le personnage mythique redevenant, grâce aux interprétations d’historiens et de théologiens, une figure historique. Être capable de cerner un sujet d’aussi loin, avec un sens chirurgical de la spéculation, rend l’intéressé apte à cerner une autre figure messianique, vulgaire celle-là : le chef d’entreprise. Le film est pour nous d’autant plus saisissant qu’il date des années 1970. On voit alors les patrons s’effaroucher et innover pour tenter de faire exister, aux belles heures du marxisme, du syndicalisme politique et du socialisme parlementaire, ce qu’on ne reconnaît plus aujourd’hui que comme les tics du pouvoir. Il s’ouvre sur une scène proprement invraisemblable, dans laquelle des chefs d’entreprise réunis redoublent d’inventivité pour trouver la tournure sémantique qui les agrée le mieux afin de se dire eux-mêmes. Or, procédant par élimination et disqualifiant tour à tour les expressions « maîtres », « patrons », « managers », « chefs d’entreprise » et quelles autres encore (« nouvel animal politique », « gagneurs » ou « conquérants du possible » !), ils se trouvent à se trahir et à se portraiturer. C’est un cas spectaculaire de dénégation freudienne : traitant de tout ce qu’ils estiment ne pas être, ils étalent d’eux-mêmes ce qu’il en est de leur fait en tant que cela est inavouable, qui plus est dans un ridicule qu’ils semblent les seuls à ne pas apprécier.
Puis, un à un, les patrons s’épanchent. Y passent l’annonce du pouvoir privé s’érigeant sous la forme des multinationales, le pouvoir anonyme d’un capital mondialisé rendant légitime la figure autoritaire et non démocratique du PDG, les nouvelles pratiques de management rendant le subordonné partenaire de la structure qui l’opprime, la neutralisation ou le dépassement de l’État social. Le pouvoir industriel et financier nous annonce lui-même, dans un français daté et dans un noir et blanc d’un autre temps, l’organisation du monde telle que nous la connaissons maintenant, celle-là même dont nous crevons.
Comme le proposent les réalisateurs dans des effets de montage, ces propos deviennent hégémoniques déjà à l’époque, et passent dans les foyers à la manière d’un évident discours de référence. C’est au plus près du développement de l’idéologie qu’on tourne ici. Plus besoin de Marx, les dirigeants parlent eux-mêmes dans les termes de l’ancienne critique, se dépersonnalisent dans de prétendues lois de l’histoire et règles du management, au sens où, s’ils se croient compétents, ils se savent surtout interchangeables. Le contraste brutal entre les prises de position des patrons et les scènes témoignant d’un accablant travail à la chaîne de la part de leurs personnels semble moins relever d’un fait de mensonge de leur part que d’une situation d’ignorance.
Comme le signalera un sociologue comme Luc Boltanski¹ à la même époque, le patron est celui qui fixe des objectifs et des directives sans nécessairement savoir par le menu comment s’organise le travail dont les rendements dépendent. David Greaber le corroborera plus tard². Paradoxalement, on finit par regretter cette époque où les dirigeants du secteur privé se montraient aussi ouvertement conscients de leur positionnement historique et social – les marxistes les y contraignaient – et aussi prolixes. (Aujourd’hui, seuls les pdg successifs de Total, en France, le restent autant.) Dans ce documentaire exceptionnel, ce n’est pas seulement leur discours qui pèse, mais le dispositif où ils choisissent d’être filmés, de même que les attributs du pouvoir qu’ils arborent et leur saillant langage du corps. C’est qu’une horde de *communicants* n’existe pas encore à l’époque pour les conseiller.
¹ Luc Boltanski, *Les cadres. La formation d’un groupe social*, Paris, les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1982.
² David Graeber, *Bureaucratie. L’utopie des règles*, Paris, Actes Sud, coll. « Babelio », 2015.
Alain Deneault
Philosophe
- Année 1978
- Pays France
- Durée 96
- Producteur INA, Laura Productions
- Langue Français
- Résumé court Douze patrons de grandes entreprises parlent face à la caméra. Du pouvoir, de la hiérarchie, des syndicats, des grèves, de l'autogestion...
- Programmateur Alain Deneault|Philosophe;