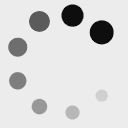Sauve qui peut

Dans un hôpital universitaire en Suisse, des étudiant·e·s en médecine et des soignant·e·s expérimenté·e·s participent à des simulations médicales. Face à des comédien·ne·s jouant le rôle de patient·e·s, iels apprennent à trouver les mots justes, à réfléchir à leurs réactions et à construire une pratique empreinte de bienveillance. Mais dans un système hospitalier de plus en plus libéral, qui exerce lui-même de la violence sur le personnel médical, cet idéal relationnel est-il réellement possible ?
| Réalisateurs | Alexe Poukine, Alexe Poukine |
| Acteurs | Itay Sapir, Itay Sapir |
| Partager sur |
Pour une personne qui, comme moi, cherche à suivre assidûment (grâce aux RIDM et à Tënk, notamment) la production contemporaine de films documentaires, mais qui n’est pas très au courant des discussions théoriques entourant les tendances actuelles, une question, sûrement un peu naïve, se pose souvent : quels sont, de nos jours, les contours délimitant le genre du documentaire, et le séparant de la fiction? Tant de films projetés dans ces contextes documentaires ces dernières années mélangent le réel et l’imaginaire de manière ostentatoire. Et même dans les films où il n’y est pas question – par exemple, pour parler de l’autre extrême, dans des films prétendument « fly on the wall » comme ceux du célèbre Frederick Wiseman –, je me demande toujours si ce qu'on y voit (les gestes, les interactions, les paroles prononcées) n’a pas été fortement influencé par la présence de la caméra. Malgré tout mon bagage théorique acquis ailleurs qui me permet de savoir qu’une représentation est toujours biaisée, artificielle, inévitablement un peu menteuse, je ne peux que me sentir berné lorsque je découvre que des scènes entières d’un film « documentaire » ont été reconstruites, rejouées, remontées.
La grande vertu du film Sauve qui peut, ce qui l’a rendu si intéressant pour moi, c'est qu’au-delà de son sujet explicite, soit les simulations de conversations entre patient·e·s et practicien·ne·s dans le milieu médical qui font partie de la formation professionnelle dans certains pays européens, il propose, par une mise en abyme ingénieuse, une réflexion profonde précisément sur ce nœud mêlant authenticité et performance, réalité et fiction, mise en scène et observation.
Durant une grande partie du film, l’on voit des ateliers de formation où des médecins ou infirmier·ère·s se trouvent devant des acteur·trice·s professionnel·le·s incarnant des patient·e·s, et s’entrainent à des conversations suivies parfois d’examens médicaux simulés, allant de situations banales tel un examen de routine jusqu’à des moments plus difficiles de l’annonce d’une mort proche et inévitable. Par la suite, le groupe analyse ce qui s’est passé lors de la simulation. Ce qui est frappant, c’est à quel point les petites saynètes ressemblent à ce que l’on voit dans des films documentaires montrant « pour de vrai » des consultations médicales (que l’on pense, récemment, à l’excellent Notre corps de Claire Simon); les acteur·trice·s, nécessairement, jouent parfaitement leurs rôles, et les étudiant·e·s exsudent gêne et maladresse, sans que l’on sache si c’est la caméra qui a cet effet ou le fait de jouer au médecin, parfois pour leur première fois dans un contexte professionnel (mais fictif). La dynamique de tout film documentaire, entre réalité vue « comme si on y était » et une performance concoctée pour nous, est répliquée à deux niveaux différents et, en quelque sorte, s’annule tout en s’exposant au grand jour.
La dernière scène du film est quelque peu différente : on est témoins d’un atelier plus long où les employé·e·s du réseau de la santé se trouvent entre elles et eux, sans autres personnes que l’animatrice. Cette fois-ci, ce n’est pas seulement la rencontre avec les patient·e·s qui est abordée, mais aussi les relations parfois tendues entre les différents corps de métier, le tout sur fond de la crise continue qui affecte pratiquement tous les systèmes de santé publics, notamment en raison du manque de personnel.
Itay Sapir
Professeur d'histoire de l'art
Université du Québec à Montréal

-

Français
1h39
Langue : Français -

English
1h39
Langue : English
- Année 2024
- Pays Belgique, France, Suisse
- Durée 99
- Producteur Wrong Men, Climage, Kidam
- Langue Français
- Sous-titres Anglais
- Résumé court Dans un centre de formation, des étudiant·e·s en médecine et des soignant·e·s expérimenté·e·s participent à des simulations médicales avec des acteur·trice·s.
- Ordre 2
- TLF_Applismb 1
- Date édito 2025-09-05
- Rail-perso-home 1
Pour une personne qui, comme moi, cherche à suivre assidûment (grâce aux RIDM et à Tënk, notamment) la production contemporaine de films documentaires, mais qui n’est pas très au courant des discussions théoriques entourant les tendances actuelles, une question, sûrement un peu naïve, se pose souvent : quels sont, de nos jours, les contours délimitant le genre du documentaire, et le séparant de la fiction? Tant de films projetés dans ces contextes documentaires ces dernières années mélangent le réel et l’imaginaire de manière ostentatoire. Et même dans les films où il n’y est pas question – par exemple, pour parler de l’autre extrême, dans des films prétendument « fly on the wall » comme ceux du célèbre Frederick Wiseman –, je me demande toujours si ce qu'on y voit (les gestes, les interactions, les paroles prononcées) n’a pas été fortement influencé par la présence de la caméra. Malgré tout mon bagage théorique acquis ailleurs qui me permet de savoir qu’une représentation est toujours biaisée, artificielle, inévitablement un peu menteuse, je ne peux que me sentir berné lorsque je découvre que des scènes entières d’un film « documentaire » ont été reconstruites, rejouées, remontées.
La grande vertu du film Sauve qui peut, ce qui l’a rendu si intéressant pour moi, c'est qu’au-delà de son sujet explicite, soit les simulations de conversations entre patient·e·s et practicien·ne·s dans le milieu médical qui font partie de la formation professionnelle dans certains pays européens, il propose, par une mise en abyme ingénieuse, une réflexion profonde précisément sur ce nœud mêlant authenticité et performance, réalité et fiction, mise en scène et observation.
Durant une grande partie du film, l’on voit des ateliers de formation où des médecins ou infirmier·ère·s se trouvent devant des acteur·trice·s professionnel·le·s incarnant des patient·e·s, et s’entrainent à des conversations suivies parfois d’examens médicaux simulés, allant de situations banales tel un examen de routine jusqu’à des moments plus difficiles de l’annonce d’une mort proche et inévitable. Par la suite, le groupe analyse ce qui s’est passé lors de la simulation. Ce qui est frappant, c’est à quel point les petites saynètes ressemblent à ce que l’on voit dans des films documentaires montrant « pour de vrai » des consultations médicales (que l’on pense, récemment, à l’excellent Notre corps de Claire Simon); les acteur·trice·s, nécessairement, jouent parfaitement leurs rôles, et les étudiant·e·s exsudent gêne et maladresse, sans que l’on sache si c’est la caméra qui a cet effet ou le fait de jouer au médecin, parfois pour leur première fois dans un contexte professionnel (mais fictif). La dynamique de tout film documentaire, entre réalité vue « comme si on y était » et une performance concoctée pour nous, est répliquée à deux niveaux différents et, en quelque sorte, s’annule tout en s’exposant au grand jour.
La dernière scène du film est quelque peu différente : on est témoins d’un atelier plus long où les employé·e·s du réseau de la santé se trouvent entre elles et eux, sans autres personnes que l’animatrice. Cette fois-ci, ce n’est pas seulement la rencontre avec les patient·e·s qui est abordée, mais aussi les relations parfois tendues entre les différents corps de métier, le tout sur fond de la crise continue qui affecte pratiquement tous les systèmes de santé publics, notamment en raison du manque de personnel.
Itay Sapir
Professeur d'histoire de l'art
Université du Québec à Montréal
-

Français
Durée : 1h39Langue : Français1h39 -

English
Durée : 1h39Langue : English1h39
- Année 2024
- Pays Belgique, France, Suisse
- Durée 99
- Producteur Wrong Men, Climage, Kidam
- Langue Français
- Sous-titres Anglais
- Résumé court Dans un centre de formation, des étudiant·e·s en médecine et des soignant·e·s expérimenté·e·s participent à des simulations médicales avec des acteur·trice·s.
- Ordre 2
- TLF_Applismb 1
- Date édito 2025-09-05
- Rail-perso-home 1