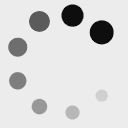Kanehsatake, 270 ans de résistance

En juillet 1990, un litige autour d'un terrain de golf qui serait construit sur des terres kanien'kéhaka (mohawks) à Oka ouvrait la voie à une confrontation historique qui ferait les manchettes internationales et s'imprimerait dans la conscience collective du pays. La réalisatrice Alanis Obomsawin – tantôt avec une petite équipe, tantôt seule – a passé 78 jours derrière les barricades kanien'kéhaka pour filmer l'affrontement armé entre les manifestants, la Sûreté du Québec et l'armée canadienne.
| Réalisateur | Alanis Obomsawin |
| Acteurs | Pascale Ferland, Pascale Ferland |
| Partager sur |
Le Québec politique rate encore aujourd’hui une belle opportunité de faire autrement; il aurait pourtant pu se démarquer en engageant les autorités autochtones dans un processus qui soit respectueux et qui reconnaît à la base le lien d’interdépendance entre l’humain et la nature.
La reconnaissance territoriale, qui demeure tabou au sein de plusieurs cercles, est en réalité l’hommage que nous portons au territoire et à ceux et celles qui portent la responsabilité de sa pérennité. La pinède de Kanehsatake, au-delà de la soi-disant crise en 1990, représente l’âme d’un peuple et demeure, même 30 ans plus tard, l’exemple le plus représentatif du statu quo politique où l’État finit toujours par imposer ses conditions, invoquant la primauté du droit.
La récente tentative du Québec de se doter d’une constitution est un rappel que les compromis demeurent unilatéraux, alors même que nous cherchons un processus à la hauteur de ce que le droit international nous reconnaît : le droit à l’autodétermination.
L’état précaire de nos écosystèmes et les rappels constants que nous fait la Terre-Mère sur l’urgence d’agir devraient idéalement nous indiquer les voies incontournables de la collaboration plutôt que le conflit. La place des peuples autochtones, leurs savoirs et la valeur qu’ils ajoutent à la science font consensus partout sur cette terre. Il ne manque que le courage et la bravoure politique pour les mettre à contribution.
Ghislain Picard
Militant innu
Ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador

-

Français
1h59
Langue : Français -

English
1h59
Langue : English
- Année 1993
- Pays Québec
- Durée 119
- Producteur ONF / NFB
- Langue Anglais
- Sous-titres Anglais, Français
- Résumé court En juillet 90, la crise d'Oka éclate. Derrière les barricades kanien'kéhaka, Alanis Obomsawin passe 78 jours à filmer le conflit armé.
- Programmateur Naomie Décarie-Daigneault|aucune;
- Ordre 5
- Feministe equitable 1
- Capsule film <p>Dans le cadre d'un entretien produit par <a href="https://realisatrices-equitables.com/" target="_blank"><span style="color:#000000;"><u>Réalisatrices Équitables</u></span></a><span style="color:#000000;">, </span>Alanis Obomsawin nous parle de son film <em>Kanehsatake, 270 ans de résistance.</em></p> <p> </p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://player.vimeo.com/video/167112261?h=24126d00e9&title=0&byline=0&portrait=0" width="854"></iframe></p>
- Logo capsule https://dhkhp2rgto9nq.cloudfront.net/img/cms/logo_RE.png
- TLF_Applismb 1
- Date édito 2025-10-24
Le Québec politique rate encore aujourd’hui une belle opportunité de faire autrement; il aurait pourtant pu se démarquer en engageant les autorités autochtones dans un processus qui soit respectueux et qui reconnaît à la base le lien d’interdépendance entre l’humain et la nature.
La reconnaissance territoriale, qui demeure tabou au sein de plusieurs cercles, est en réalité l’hommage que nous portons au territoire et à ceux et celles qui portent la responsabilité de sa pérennité. La pinède de Kanehsatake, au-delà de la soi-disant crise en 1990, représente l’âme d’un peuple et demeure, même 30 ans plus tard, l’exemple le plus représentatif du statu quo politique où l’État finit toujours par imposer ses conditions, invoquant la primauté du droit.
La récente tentative du Québec de se doter d’une constitution est un rappel que les compromis demeurent unilatéraux, alors même que nous cherchons un processus à la hauteur de ce que le droit international nous reconnaît : le droit à l’autodétermination.
L’état précaire de nos écosystèmes et les rappels constants que nous fait la Terre-Mère sur l’urgence d’agir devraient idéalement nous indiquer les voies incontournables de la collaboration plutôt que le conflit. La place des peuples autochtones, leurs savoirs et la valeur qu’ils ajoutent à la science font consensus partout sur cette terre. Il ne manque que le courage et la bravoure politique pour les mettre à contribution.
Ghislain Picard
Militant innu
Ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador
-

Français
Durée : 1h59Langue : Français1h59 -

English
Durée : 1h59Langue : English1h59
- Année 1993
- Pays Québec
- Durée 119
- Producteur ONF / NFB
- Langue Anglais
- Sous-titres Anglais, Français
- Résumé court En juillet 90, la crise d'Oka éclate. Derrière les barricades kanien'kéhaka, Alanis Obomsawin passe 78 jours à filmer le conflit armé.
- Programmateur Naomie Décarie-Daigneault|aucune;
- Ordre 5
- Feministe equitable 1
- Capsule film <p>Dans le cadre d'un entretien produit par <a href="https://realisatrices-equitables.com/" target="_blank"><span style="color:#000000;"><u>Réalisatrices Équitables</u></span></a><span style="color:#000000;">, </span>Alanis Obomsawin nous parle de son film <em>Kanehsatake, 270 ans de résistance.</em></p> <p> </p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://player.vimeo.com/video/167112261?h=24126d00e9&title=0&byline=0&portrait=0" width="854"></iframe></p>
- Logo capsule https://dhkhp2rgto9nq.cloudfront.net/img/cms/logo_RE.png
- TLF_Applismb 1
- Date édito 2025-10-24