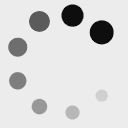L'erreur boréale

Alors que le silence et l’ignorance règnent en maîtres sur nos forêts, et malgré le discours officiel qui nous assure que le patrimoine forestier demeurera intact, ce documentaire-choc soulève la question de la responsabilité collective devant la destruction d’un environnement unique au monde. La forêt boréale, cette importante richesse que l’on croyait inépuisable, est-elle réellement entre bonnes mains?
| Réalisateurs | Richard Desjardins, Richard Desjardins, Robert Monderie, Robert Monderie |
| Acteurs | Pascale Ferland, Pascale Ferland |
| Partager sur |
J’ai commencé à militer en 1972, après avoir lu le Rapport Meadows, Les limites à la croissance. Ce fut un réveil brutal : nous, les humain·e·s, consommions déjà plus que ce que la Terre pouvait produire.
En réponse à ce constat alarmant, plusieurs gouvernements ont créé leur ministère de l’Environnement – censé agir comme « chien de garde » pour réguler l’exploitation de notre capital naturel –, et éviter que nous ne dépassions les capacités de la planète. Le mouvement citoyen, alors naissant et rempli d’espoir, s’est mobilisé en participant à la mise sur pied de projets de conservation, de recyclage et de sensibilisation.
Dans les vingt années qui suivirent, malgré les beaux discours « verts » des politicien·ne·s et les accomplissements de groupes citoyens engagés et optimistes, les rapports sur l’état de la planète continuaient de démontrer que la consommation, loin de se stabiliser, augmentait toujours. En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, on réalisait déjà que l’humanité consommait davantage que ce que la planète pouvait régénérer chaque année.
Vingt ans plus tard, ce combat pour les limites planétaires prit chez nous une tournure bien concrète. En 1999, la sortie du documentaire L’erreur boréale eut dans la population l’effet d’un séisme de magnitude 8 sur l’échelle de Richter. Nos gouvernants tentèrent d’ignorer la secousse, espérant que le peuple oublierait et qu’on passerait à autre chose. Mais nous n’allions pas baisser les bras. Rapidement, Richard, moi et quelques autres guerriers verts avons décidé de fonder l’Action boréale, afin de brasser la cage, de mobiliser la population et de forcer nos dirigeant·e·s à mettre sur pied une commission d’enquête sur l’état de notre forêt publique, ce bien collectif qui représente 92% du territoire forestier québécois.
Sous la pression, le gouvernement créa la Commission Coulombe pour rassurer la population et, disons-le, tenter de nous « fermer la gueule ». À la sortie de son rapport, en 2004, celui-ci nous donna toutefois raison : on surexploitait bel et bien la ressource.
À la même époque, le gouvernement signa à Rio la Convention sur la diversité biologique qui l’engageait à protéger 12 % de son territoire. En Abitibi, seulement 0,4% du territoire était protégé en 2000. L’Action boréale s’attela à la tâche et, dix ans plus tard, la proportion atteignait 8%. Pas mal pour un petit groupe qui n’a jamais reçu une cenne de subvention de personne.
Aujourd’hui, en 2025, malgré les belles paroles politiciennes, la guerre pour la conservation continue de plus belle. Nos gouvernements, acoquinés à l’industrie extractive, facilitent et accélèrent toujours la transformation en planches de 2x4 et en pâte à papier du peu qu’il reste de nos écosystèmes forestiers encore intacts.
Le jour du dépassement est tombé le 24 juillet cette année. À l’échelle mondiale, nous consommons déjà l’équivalent des ressources de deux planètes pour satisfaire notre appétit gargantuesque. Le hic, c’est que nous n’en avons qu’une seule. Et si tous les humain·e·s vivaient comme nous, Québécois·e·s, Canadien·ne·s ou Américain·e·s, il nous faudrait quatre planètes pour subvenir à nos besoins.
Alors, pourquoi continuer à lutter? Simplement parce que nous sommes en guerre. La dernière. Car si nous détruisons tout, il n’y aura plus rien à défendre, ni personne pour le faire. En tant qu’êtres humains, notre devoir est de nous battre pour nos enfants et pour leur descendance.
Nous sommes le petit David face au géant Goliath. Et, si je me souviens bien de l’histoire, après la troisième pierre lancée, c’est Goliath qui est tombé.
Henri Jacob
Écologiste et cofondateur de l'Action boréale

-

Français
1h09
Langue : Français
- Année 1999
- Pays Québec
- Durée 69
- Producteur ACPAV
- Langue Français, Cri
- Sous-titres Français
- Résumé court Documentaire-choc sur la gestion de la forêt boréale québécoise, à l’origine d’une importante commission politique et d’un projet de loi sur les forêts.
- Mention festival Prix Jutra - meilleur documentaire
- Ordre 4
- TLF_Applismb 1
- Date édito 2025-10-24
J’ai commencé à militer en 1972, après avoir lu le Rapport Meadows, Les limites à la croissance. Ce fut un réveil brutal : nous, les humain·e·s, consommions déjà plus que ce que la Terre pouvait produire.
En réponse à ce constat alarmant, plusieurs gouvernements ont créé leur ministère de l’Environnement – censé agir comme « chien de garde » pour réguler l’exploitation de notre capital naturel –, et éviter que nous ne dépassions les capacités de la planète. Le mouvement citoyen, alors naissant et rempli d’espoir, s’est mobilisé en participant à la mise sur pied de projets de conservation, de recyclage et de sensibilisation.
Dans les vingt années qui suivirent, malgré les beaux discours « verts » des politicien·ne·s et les accomplissements de groupes citoyens engagés et optimistes, les rapports sur l’état de la planète continuaient de démontrer que la consommation, loin de se stabiliser, augmentait toujours. En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, on réalisait déjà que l’humanité consommait davantage que ce que la planète pouvait régénérer chaque année.
Vingt ans plus tard, ce combat pour les limites planétaires prit chez nous une tournure bien concrète. En 1999, la sortie du documentaire L’erreur boréale eut dans la population l’effet d’un séisme de magnitude 8 sur l’échelle de Richter. Nos gouvernants tentèrent d’ignorer la secousse, espérant que le peuple oublierait et qu’on passerait à autre chose. Mais nous n’allions pas baisser les bras. Rapidement, Richard, moi et quelques autres guerriers verts avons décidé de fonder l’Action boréale, afin de brasser la cage, de mobiliser la population et de forcer nos dirigeant·e·s à mettre sur pied une commission d’enquête sur l’état de notre forêt publique, ce bien collectif qui représente 92% du territoire forestier québécois.
Sous la pression, le gouvernement créa la Commission Coulombe pour rassurer la population et, disons-le, tenter de nous « fermer la gueule ». À la sortie de son rapport, en 2004, celui-ci nous donna toutefois raison : on surexploitait bel et bien la ressource.
À la même époque, le gouvernement signa à Rio la Convention sur la diversité biologique qui l’engageait à protéger 12 % de son territoire. En Abitibi, seulement 0,4% du territoire était protégé en 2000. L’Action boréale s’attela à la tâche et, dix ans plus tard, la proportion atteignait 8%. Pas mal pour un petit groupe qui n’a jamais reçu une cenne de subvention de personne.
Aujourd’hui, en 2025, malgré les belles paroles politiciennes, la guerre pour la conservation continue de plus belle. Nos gouvernements, acoquinés à l’industrie extractive, facilitent et accélèrent toujours la transformation en planches de 2x4 et en pâte à papier du peu qu’il reste de nos écosystèmes forestiers encore intacts.
Le jour du dépassement est tombé le 24 juillet cette année. À l’échelle mondiale, nous consommons déjà l’équivalent des ressources de deux planètes pour satisfaire notre appétit gargantuesque. Le hic, c’est que nous n’en avons qu’une seule. Et si tous les humain·e·s vivaient comme nous, Québécois·e·s, Canadien·ne·s ou Américain·e·s, il nous faudrait quatre planètes pour subvenir à nos besoins.
Alors, pourquoi continuer à lutter? Simplement parce que nous sommes en guerre. La dernière. Car si nous détruisons tout, il n’y aura plus rien à défendre, ni personne pour le faire. En tant qu’êtres humains, notre devoir est de nous battre pour nos enfants et pour leur descendance.
Nous sommes le petit David face au géant Goliath. Et, si je me souviens bien de l’histoire, après la troisième pierre lancée, c’est Goliath qui est tombé.
Henri Jacob
Écologiste et cofondateur de l'Action boréale
-

Français
Durée : 1h09Langue : Français1h09
- Année 1999
- Pays Québec
- Durée 69
- Producteur ACPAV
- Langue Français, Cri
- Sous-titres Français
- Résumé court Documentaire-choc sur la gestion de la forêt boréale québécoise, à l’origine d’une importante commission politique et d’un projet de loi sur les forêts.
- Mention festival Prix Jutra - meilleur documentaire
- Ordre 4
- TLF_Applismb 1
- Date édito 2025-10-24