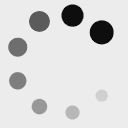Kashima Paradise

Vers 1970, entre Kashima et Tokyo, se construit l’aéroport de Narita. Les paysan·ne·s refusent de vendre leurs terres et affrontent les gardes mobiles envoyés pour les expulser. À travers ces lieux symboliques de la modernisation du Japon, _Kashima Paradise_ dresse le portrait sociologique d’une nation et démontre comment ses traditions ancestrales ont été instrumentalisées par le capitalisme pour accélérer les mutations sociales et politiques. Filmé en noir et blanc avec une rigueur formelle remarquable, ce film est devenu une référence du cinéma militant des années 1970.
| Réalisateurs | Bénie Deswarte, Yann Le Masson |
| Acteur | Richard Brouillette |
| Partager sur |
Comme un brûlot fendant la mer étale d’une morne et flasque nuit, Kashima Paradise, a su mettre le feu aux poudres d’une cinématographie militante qui à peine ouvrait les yeux. Rapidement élu film phare du cinéma engagé, ses étincelles ont allumé des feux un peu partout – et jusqu’au Québec où, d’ailleurs, sa coréalisatrice, Bénie Deswarte, allait un jour s’installer. Si ses images saisissantes du soulèvement des paysans expropriés de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Narita – véritable jacquerie des temps modernes – n’y étaient pas pour rien, sa forme générale y était pour beaucoup.
Car, immergés dans la communauté du petit village de Takeï (450 habitant·e·s), également en proie à l’expropriation par le tentaculaire keiretsu (conglomérat) Mitsubishi, les cinéastes choisirent leur arme de prédilection dans ce combat qui allait les opposer à la classe dominante japonaise : le temps. « Cette chose qui manque le plus à la plupart d'entre nous, particulièrement aux cinéastes », comme l’écrivait Chris Marker à propos du film, dont il a signé le commentaire. « Le temps de travailler, et aussi, et surtout de ne pas travailler. Le temps de parler, d'écouter et surtout de se taire. Le temps de filmer et de ne pas filmer, de comprendre et de ne pas comprendre, de s'étonner et d'attendre l'au-delà de l'étonnement, le temps de vivre. »
En effet, la démarche des cinéastes, bien que militante, s’inscrit d’abord et avant tout dans l’esprit du cinéma direct, pour lequel vivre – longtemps – avec les gens qu’on filme est gage d’authenticité à travers la rencontre des subjectivités. Il y a là, d’ailleurs, une certaine filiation avec l’approche de proximité patiente de Georges Rouquier pour Farrebique, qui intervient dans Kashima Paradise comme narrateur. Suivant une pratique qu’on qualifierait aujourd’hui de « participative », Le Masson et Deswarte projetaient même régulièrement leurs rushes aux paysan·ne·s assemblé·e·s.
Ainsi, en esquissant le portrait de cette société nippone qui chante la gloire d’un modernisme effréné, tout en se trouvant toujours transie de féodalisme et de misogynie, le film oppose la vie vivante du quotidien à l’ordre immuable des choses, celui régi par la hiérarchie inflexible des classes sociales japonaises et, en particulier, par le giri, à la fois code d’honneur et obligation sociale. « S’en évader, impossible. Vous n’existez que par le groupe, hors du groupe, vous n’êtes pas libres, vous êtes orphelins », nous dit la voix off. En ce sens, le film est une invitation au désordre, car comme le disait ironiquement Brecht dans ses Dialogues d’exilés, « De nos jours, il y a de l’ordre surtout là où il n’y a rien. »
Richard Brouillette
Cinéaste, producteur, éleveur de poules et comptable

-

Français
1h45
Langue : Français
Sous-titres : Français -

English
1h45
Langue : English
Sous-titres : English
- Année 1973
- Pays France
- Durée 105
- Producteur Les films Grain de Sable
- Langue Français, Japonais
- Sous-titres Français, Anglais
- Résumé court Une analyse des rapports de force opposant des paysan·ne·s aux grands groupes industriels japonais lors de la construction de l’aéroport de Narita au début des années 70.
- Date édito 2025-09-12
Comme un brûlot fendant la mer étale d’une morne et flasque nuit, Kashima Paradise, a su mettre le feu aux poudres d’une cinématographie militante qui à peine ouvrait les yeux. Rapidement élu film phare du cinéma engagé, ses étincelles ont allumé des feux un peu partout – et jusqu’au Québec où, d’ailleurs, sa coréalisatrice, Bénie Deswarte, allait un jour s’installer. Si ses images saisissantes du soulèvement des paysans expropriés de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Narita – véritable jacquerie des temps modernes – n’y étaient pas pour rien, sa forme générale y était pour beaucoup.
Car, immergés dans la communauté du petit village de Takeï (450 habitant·e·s), également en proie à l’expropriation par le tentaculaire keiretsu (conglomérat) Mitsubishi, les cinéastes choisirent leur arme de prédilection dans ce combat qui allait les opposer à la classe dominante japonaise : le temps. « Cette chose qui manque le plus à la plupart d'entre nous, particulièrement aux cinéastes », comme l’écrivait Chris Marker à propos du film, dont il a signé le commentaire. « Le temps de travailler, et aussi, et surtout de ne pas travailler. Le temps de parler, d'écouter et surtout de se taire. Le temps de filmer et de ne pas filmer, de comprendre et de ne pas comprendre, de s'étonner et d'attendre l'au-delà de l'étonnement, le temps de vivre. »
En effet, la démarche des cinéastes, bien que militante, s’inscrit d’abord et avant tout dans l’esprit du cinéma direct, pour lequel vivre – longtemps – avec les gens qu’on filme est gage d’authenticité à travers la rencontre des subjectivités. Il y a là, d’ailleurs, une certaine filiation avec l’approche de proximité patiente de Georges Rouquier pour Farrebique, qui intervient dans Kashima Paradise comme narrateur. Suivant une pratique qu’on qualifierait aujourd’hui de « participative », Le Masson et Deswarte projetaient même régulièrement leurs rushes aux paysan·ne·s assemblé·e·s.
Ainsi, en esquissant le portrait de cette société nippone qui chante la gloire d’un modernisme effréné, tout en se trouvant toujours transie de féodalisme et de misogynie, le film oppose la vie vivante du quotidien à l’ordre immuable des choses, celui régi par la hiérarchie inflexible des classes sociales japonaises et, en particulier, par le giri, à la fois code d’honneur et obligation sociale. « S’en évader, impossible. Vous n’existez que par le groupe, hors du groupe, vous n’êtes pas libres, vous êtes orphelins », nous dit la voix off. En ce sens, le film est une invitation au désordre, car comme le disait ironiquement Brecht dans ses Dialogues d’exilés, « De nos jours, il y a de l’ordre surtout là où il n’y a rien. »
Richard Brouillette
Cinéaste, producteur, éleveur de poules et comptable
-

Français
Durée : 1h45Langue : Français
Sous-titres : Français1h45 -

English
Durée : 1h45Langue : English
Sous-titres : English1h45
- Année 1973
- Pays France
- Durée 105
- Producteur Les films Grain de Sable
- Langue Français, Japonais
- Sous-titres Français, Anglais
- Résumé court Une analyse des rapports de force opposant des paysan·ne·s aux grands groupes industriels japonais lors de la construction de l’aéroport de Narita au début des années 70.
- Date édito 2025-09-12