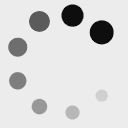Vivre la Syrie (2011-2023)

Découvrez une nouvelle génération de cinéastes née au cœur de la révolution syrienne, qui a fait du documentaire un véritable outil de résistance.
La situation en Syrie, depuis le début de la révolution en 2011, a été documentée de manière extensive par les Syrien·ne·s qui ont filmé la révolution, la guerre, les contraintes liées à leurs déplacements, en Syrie comme à l’étranger. Si un très grand nombre de vidéos ont par exemple circulé sur YouTube, un certain nombre de personnes sont devenues cinéastes, sans pour autant l’avoir planifié. Le documentaire a connu un véritable essor à cette occasion : ce type de cinéma a été capable de s’imposer depuis 2011 pour des raisons pratiques, sans pour autant nier des raisons éthiques et politiques. Si les cinéastes avaient jusqu’en 2011 des marges de manœuvre au sein d’une industrie cinématographique encadrée par l’État, les choses sont devenues différentes avec le début de la révolution devenue guerre. Les cinéastes ont fait face à une politique de plus en plus répressive où quiconque était pris à filmer a fini par risquer la mort, dans la rue ou en prison. C’est donc dans une configuration entièrement inédite et extrêmement difficile que se sont développées de nouvelles manières de faire du cinéma dans le pays et qu’a émergé une nouvelle génération de cinéastes qui contestait de manière plus directe le régime et sa politique. Dans ce contexte, les conditions de production étaient particulièrement éprouvantes et il ne s’agissait plus seulement de penser technique cinématographique ou narration : faire des films c’était d’abord apprendre à chiffrer ses disques durs, à cacher son matériel dans son plâtre lorsque l’on voyage, ou encore demander à d’autres de faire des images pour soi lorsque les déplacements étaient rendus impossibles. En somme, faire du cinéma en Syrie c’était développer des stratégies de contournement et créer l’infrastructure permettant à ces films d’exister.
Depuis la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, la culture a retrouvé une place dans l’espace public : des films réalisés par des cinéastes syrien·ne·s ont été projetés pour la première fois dans le pays et de nouveaux projets cinématographiques ont ouvertement vu le jour. Dans un pays où l’avenir reste fragile, la reconstruction s’amorce, timide : près de 20 % des exilé·e·s sont rentré·e·s, les familles traquent les traces de leurs disparu·e·s, et une parole se libère, comme la Syrie n’en a pas connu au cours des décennies Assad, père et fils. Une nouvelle phase s’ouvre pour la création cinématographique syrienne, sur laquelle il vaudra la peine de garder un œil. Cette escale cinématographique revient sur trois documentaires, trois expériences de la Syrie entre 2011 et 2023, capturées par de jeunes cinéastes dont la plupart ont commencé à filmer dès le début de la révolution. Trois regards, à la fois affirmés et délicats, où se dessinait déjà l’espoir d’un autre rapport des Syrien·ne·s à leur pays.
Justine Pignato
Chercheuse en études cinématographiques et médiatiques
et programmatrice
Un mot de notre programmatrice
Si mon expérience de vie au Liban m’a poussée à m’intéresser de près à la Syrie alors que venaient s’installer à Beyrouth un grand nombre de réfugié·e·s syrien·ne·s, j’ai pleinement découvert le cinéma syrien au FID Marseille (festival de cinéma de Marseille, France) où j’ai travaillé l’année suivante. J’ai été intriguée par le fait que des films documentaires faits par des Syriens et Syriennes soient en mesure de circuler dans des festivals internationaux alors que le pays avait basculé dans la guerre. Je me suis très rapidement posé une question simple : comment est-il possible de fabriquer des films documentaires dans ces conditions? C’est à cette question que j’ai décidé de consacrer ma thèse de doctorat, publiée en 2024 et intitulée « Produire un film documentaire à visibilité internationale dans une Syrie marquée par la guerre (2011-2021) : un processus infrastructurel, mobilitaire et transnational ». Intéressée par les aspects pratiques de la fabrication de ces films, j’ai attaché une grande importance aux discussions que j’ai menées avec les Syriens et Syriennes impliqué·e·s.
3 produits

Still Recording
Accès abonnement
Pendant cinq ans, au cœur de la guerre civile syrienne, un groupe d’apprentis cinéastes filme les combats et la vie quotidienne de la population de la ville de Douma, en Ghouta orientale, une banlieue assiégée de Damas.

Chasing the Dazzling Light
Accès abonnement
Le réalisateur Yaser Kassab a suivi les traces de son père en quittant la Syrie pour l’Europe alors qu’il était jeune, rêvant comme lui de devenir cinéaste. Aujourd’hui, les deux travaillent ensemble sur ce film à distance. Depuis la Syrie, le père guide son fils au téléphone ou par visioconférence, lui prodiguant des conseils sur ses futurs projets cinématographiques et sur sa vie en général —...

Damascus is Breathing
Accès abonnement
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le réalisateur Omar Malas s’est posé une question : quel sera l’impact de la pandémie sur les Syrien·ne·s après des années de guerre? Ce projet documentaire est une tentative de retranscrire le travail d’une initiative citoyenne à laquelle il a participé pendant la première vague de la pandémie.

Still Recording
Accès abonnement
Pendant cinq ans, au cœur de la guerre civile syrienne, un groupe d’apprentis cinéastes filme les combats et la vie quotidienne de la population de la ville de Douma, en Ghouta orientale, une banlieue assiégée de Damas.

Chasing the Dazzling Light
Accès abonnement
Le réalisateur Yaser Kassab a suivi les traces de son père en quittant la Syrie pour l’Europe alors qu’il était jeune, rêvant comme lui de devenir cinéaste. Aujourd’hui, les deux travaillent ensemble sur ce film à distance. Depuis la Syrie, le père guide son fils au téléphone ou par visioconférence, lui prodiguant des conseils sur ses futurs projets cinématographiques et sur sa vie en général —...

Damascus is Breathing
Accès abonnement
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le réalisateur Omar Malas s’est posé une question : quel sera l’impact de la pandémie sur les Syrien·ne·s après des années de guerre? Ce projet documentaire est une tentative de retranscrire le travail d’une initiative citoyenne à laquelle il a participé pendant la première vague de la pandémie.